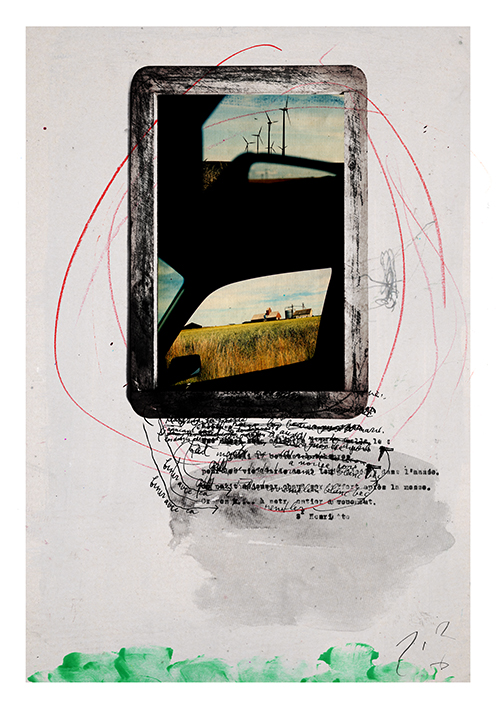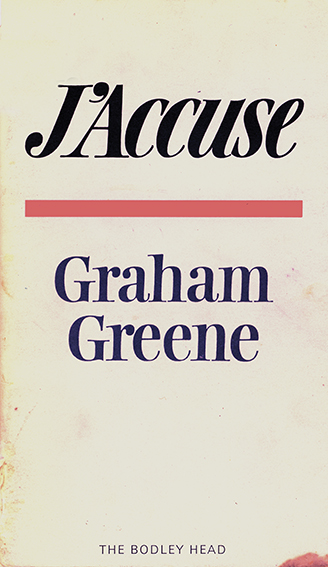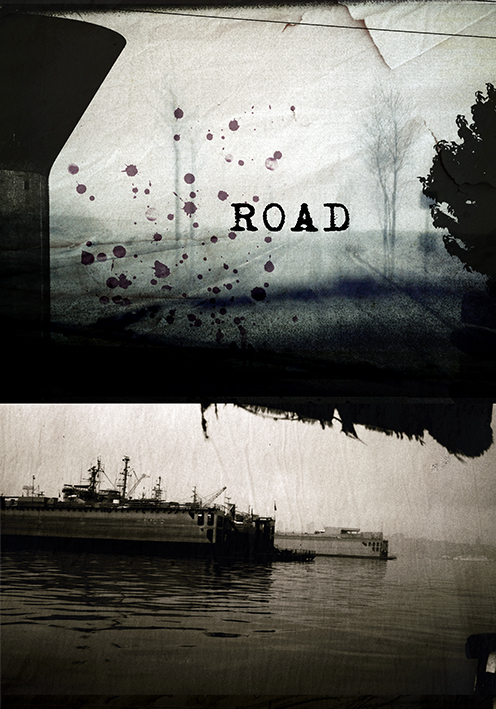L’ensemble ce travail prend ses racines à l’intérieur de ma voiture lorsque j’accompagnais dans nos déambulations l’écrivain Graham Greene.
Au détour d’une conversation, il me racontait par bribes les épisodes de son dernier rêve.
Chaque jour, il les consignait par écrit*. Chez lui, c’était une obsession, un rituel.
Ces rêves dits au jour le jour et portés sur les parois de mon inconscient me révélaient
des continents d’aventures.
L’image d’un mot, d’une idée, d’une situation transformait la surface du pare-brise en un vaste écran plat.
Durant ces égarements nocturnes, ma conduite devenait stratosphérique, spatiale et lunaire.
Ébranlé, je vivais en temps réel le déroulement d’un film que je composais dans l’urgence au gré des embouteillages. Playtime et Jour de fête s’invitaient dans ce trafic critique. Graham Greene aimait le cinéma. Il détestait les films d’Alfred Hitchock. Il boudait Antony Burgess pour des pécadilles. Il appréciait Charlie Chaplin et ses films. Espiègle, il joua Incognito l’assureur anglais dans La nuit américaine de François Truffaut. Le metteur en scène l’apprit sur le tard.
C’est ainsi que prit forme l’épisode 1 de ces rocambolesques voyages faits d’images argentiques superposées sous le titre de 12 voyages pour Graham Greene sous forme de lettres photographiques.
Dans l’épisode 2, je poursuis de manière différente les intrigues picturales de ce dialogue
romanesque sous le titre générique : l’Errance du Monde, les temps morts de l’utopie ou mon désespoir est imparfait..
Je cherche une empreinte sensible, un verbe, une musicalité, un langage poétique ou les rêves et le réel qui se conjuguent avec la narration des images. S’ensuis dans les hasards de ce parcours d’autres thèmes ou séries. Ils sont traités comme des saisons.
Ces saisons s’agrippent et serpentent tels des rhizomes à ce tronc générique.
C’est à partir de cette période que j’use d’un autre nom, d’un surnom, celui de Lookace Bamber.
EXIT, l’errance / Pour Graham Greene.
Il le fallait. Pour mettre en images et en mots cette longue nuit d’attente durant laquelle mes rêvent me travaillaient au corps, pour achever ce marathon de mots et d’images qui affluaient de toutes parts, il était nécessaire que je trouve le bon carburant, l’élixir bienfaisant. Et il m’a fallu du temps. Oui, tout ce temps. Le temps d’une maladie que l’on se fabrique dans l’espoir de jours meilleurs.
Je me souviens du dernier jour de notre rencontre. Il n’y avait pas d’enfer dans cette saison, ni de pluies. C’était en 1988 dans la tour carrée du musée de la Castres à Cannes par un bel après-midi de novembre froid et ensoleillé. J’exposais mes photographies. Ces images, elles vous étaient dédiées. Ce n’était pas un hommage, simplement un invisible merci.
Fatigué, vous vous êtes déplacé malgré tout. Votre grand corps malade peinait.
Je revois votre visage, votre regard, j’entends encore votre voix marquée par le poids de vos maux.
Je vous ai raccompagné à votre domicile à Antibes. Assis sur le rebord de votre lit, face à la bibliothèque de votre chambre, vous m’avez dédicacé votre J’accuse. Livre prêté, jamais rendu. Au-dessus de la tête de votre lit, accrochée au mur, la photographie d’un nu. Je me suis souvenu d’une question que je vous avais posée lors de nos équipées : à part la littérature, quelles sont vos autres passions ?
Vous m’avez répondu : C’était… et vous vous êtes repris en me disant : Les femmes. J’ai souri. Nous avons bu un, deux whiskies. Ce n’était pas du cinéma, juste la dernière image, la dernière séance, le dernier regard que nous partagions. Nous avons bavardé de tout et de rien. Nous avons laissé nos souvenirs et nos espoirs s’éteindre dans la sépulture d’un siècle révolu.
Retour.
Nous sommes en 1981. Vous rédigiez votre ouvrage J’accuse, un pamphlet contre les pratiques du milieu mafieux et affairiste de la Côte d’Azur**. Publiée dans le Times, une bonne page de votre manuscrit – je ne connaissais que ce passage – relatait les agissements de la pègre sur la Riviera. Cela mit le feu aux poudres, fit scandale. Le maire de Nice, Jacques Médecin, porte-parole outragé de cette nébuleuse obscure, vous traita de « vieux con ».
Vu aussi sur la porte de votre appartement, une carte épinglée avec pour signature « Go Home ».
Écouté dans votre petit deux-pièces d’Antibes, le combat de Renée Le Roux en quête d’indices sur la disparition de sa fille Agnès.
Le livre fut interdit à la vente sur le territoire français pour atteinte à la vie privée par décision de justice.
C’est à cette période que nous avons fait connaissance.
Je pigeais pour FR3 Côte d’Azur et pour Le Nouvel HEBDO. Ce tabloïd était piloté en sous-main par Max Gallo, écrivain, historien et député des Alpes Maritimes. Je devais vous photographier.
Malgré votre détestation de vous faire tirer le portrait, la chose fut faite.
Plus tard, vous m’avez demandé de vous accompagner sur les hauteurs de Nice pour photographier la construction d’immeubles supposée être financée par de l’argent sale. À chaque fois que nous prenions ma voiture pour ces repérages, il y avait un moment qui se transformait en un rituel épique : vous me racontiez dans le détail, les péripéties extravagantes de votre dernier rêve.
Je me rappelle celui-ci :
Nous roulions précisément sur la promenade des Anglais. Vous étiez au Congo. Embarqué dans une longue pirogue d’ébène, vous descendiez le fleuve accompagné d’hommes et de femmes indigènes. Au centre, une femme blanche était assise. Tout en vous écoutant, le pare-brise de mon automobile devenait, par magie, l’écran fantasmé de votre histoire. Dans ce cadre panoramique s’invitait et se superposait une autre vision bien réelle, celle de tous les marquages sur l’asphalte de la chaussée et ses chausse-trappes. Le pare-brise, devenu écran cinématographique, se bâfrait d’atterrissages et de décollages d’avions entre deux feux de croisements, absorbait les publicités, les façades d’immeubles au style rococo, le flot polluant des bagnoles, les palmiers ornementaux et les passants sans soucis sortis par mégarde des clichés de Martin Parr. Tout ce méli-mélo sucré, chaotique, s’introduisait en force dans le cadre de ce scénario mouvementé.
Ces fragments d’images se croisaient, s’imbriquaient et interféraient entre eux sans hiérarchie dans les scènes de vos aventures nocturnes.
Remix godarien, flash-back inachevé, je conduisais ce film au rythme des injonctions et des règles du code de la route. J’étais le metteur en scène et le machiniste involontaire de ce kaléidoscope et vous, le scénariste exalté dans les lumières éphémères d’une série B.
À l’aide de ces morceaux épars, j’inventais, je remontais, je captais, je rebondissais, je combinais les desseins d’une histoire à venir, à écrire. J’avais alors la folle envie de donner corps à ce corpus d’images et de mots, j’avais le désir pressant de faire de ces balbutiements la trame d’une autofiction, l’écriture zigzagante d’une série sous la forme de lettres photographiques.
C’est à ce moment-là que je fis dans l’urgence le montage des premières photographies de l’exposition présentée au musée de la Castre à Cannes.
Je cherchais à leur donner un semblant de cohérence. Ce travail se composait de 12 planches, chacune faite de deux photographies argentiques, en noir et blanc, superposées donnant ainsi l’illusion d’un seul cliché. Elles parlaient de voyages, d’évasion. Elles me semblaient froides et distantes, ils leur manquaient l’odeur d’un frisson, quelque chose d’intime, la chaleur de l’exaltation de l’aventure. J’avais atteint ma limite.
J’ai laissé de longues années ce travail au repos.
Aujourd’hui, je les reprends. Je les numérise, je les brutalise. Je modifie leurs amorces, leurs textures. Je leur donne un ton, une figure qui se veut épistolaire en échos aux dérives oratoires de vos rêves et par extension à l’errance du Monde, à ma vie vagabonde, à mes vagues à l’âme, à ce repli sur la mémoire de mes images. Elles m’interrogent et elles me déconcertent.
Je garde pour repère, les noirs profonds des images du Troisième homme, le film de Carol Reed et l’obsédante musique d’Anton Karas qui scande l’intrigue de votre scénario, souvenance visuelle de la fin de la seconde guerre mondiale dans les décombres et les égouts de la ville de Vienne.
Vous, vous avez peint et décrit dans vos romans et dans vos essais les tourments et les états de l’âme
humaine dans l’hérésie guerrière et meurtrière de cette fin du XXème siècle. Vous y avez participé en catimini comme agent secret, comme journaliste. Il me revient à l’esprit des bribes de nos brèves discussions à propos de l’agent double Kim Phiby réfugié à Moscou et de votre visite à votre ami – m’avez-vous dit -, Iouri Andropov alors Président du Soviet Suprême de l’URSS et ancien responsable du KGB***. Ces amitiés me semblaient abracadabrantesques issues d’un monde, sans joie ni loi, à l’image de Janus.
- 1989. Icône géographique et centrale d’un monde bipolaire, Berlin perdait son mur dans cette queue de comète.
Les horreurs de cette époque, remisées tant bien que mal sous le tapis, resurgissent aujourd’hui sous d’autres formes transversales, laissant des espaces à de nouveaux débordements sanglants et à ses lots de catastrophes à venir, de diverses natures. S’ajoutent, au cancer des folies humaines, les pandémies encore inconnues et les guerres asymétriques, de hautes intensités ou apocalyptiques. Putain d’Histoire. Humanité des faims et fin d’humanité. Les productions industrielles, les crises économiques, politiques, religieuses et environnementales se succèdent. Elles accompagnent une nouvelle Ère enténébrée dans le purgatoire de nos fragilités. Que me reste-t-il d’intimité et de lucidité au milieu de ces confusions ? Faire de l’art à t-il du sens dans le chaos de ce précipité ? Je l’espère, sans trop y croire. Je résiste comme je le peux à la doxa envahissante et manipulatrice. Pas certain. Du doute. Exister. Vivre. Aimer. Échanger. Partager. Chercher les voix et le chant d’un langage vivant face à l’usure de mes mots, de mes images, de mes apprentissages, pour entrevoir si possible, l’ouverture salutaire d’un nouvel espoir.
Lookace Bamber, le quai des songes. Amiens
Notes.
* 1- Adolescent Graham Greene était tourmenté, dépressif et fugueur. Sur les conseils de son père, il fit une cure psychanalytique en1920, rare pour l’époque en Angleterre. Il avait 16 ans. Pendant six mois il demeura en pension chez l’analyste Kenneth Richmond. Celui-ci lui conseilla de transcrire ses rêves, ce qu’il fit durant sa vie. Voici un extrait d’une lettre d’Yvonne Cloetta – sa maitresse – qu’elle m’adressa le 22-05-91 de Corseaux en Suisse : Une semaine environ, avant sa mort, il m’a confié une lourde tâche : en effet depuis très longtemps, il tenait un journal de ses rêves. Et puis un jour, il avait décidé de faire un livre. Ce livre, il n’a pas eu la force de le terminer. Le dossier est resté là sur son bureau avec, en couverture A world of my own, un monde à moi. Je n’ai eu, pour l’instant, ni le temps, ni le courage de m’y atteler, mais puisque, sur son lit d’hôpital, il m’a demandé de le mettre en page, j’ai promis de faire tout mon possible et je le ferai. Le livre est paru sous le titre Mon univers secret chez l’éditeur Robert Laffont, dans la collection Pavillon en 1994.
** 2- A l’époque, je connaissais seulement la page du manuscrit du J’accuse de Graham Greene publiée dans le Times : « si vous envisagez de vous installer sur la Côte d’Azur dans l’espoir de mener une existence paisible, permettez-moi de vous adresser une mise en garde amicale : Éviter Nice et ses environs. La région est en effet devenue la chasse gardée de certaines organisations les plus criminelles de France ». Graham Greene travaillait encore à la rédaction de l’ouvrage. Il cherchait des preuves, des appuis et des conseils. Le regard de Graham Greene sur la violence faite aux femmes illustre le contexte maffieux et patriarcal qui sévissait sur la Côte.
*** 3- A ma connaissance je ne connais pas d’écrit de Graham Greene mentionnant cette amitié. Dans le cours d’une conversation, lors d’un diner à mon domicile il me fit cette confidence et ajouta qu’Iouri Andropov lui avait remis une lettre pour le palais de l’Élysée.